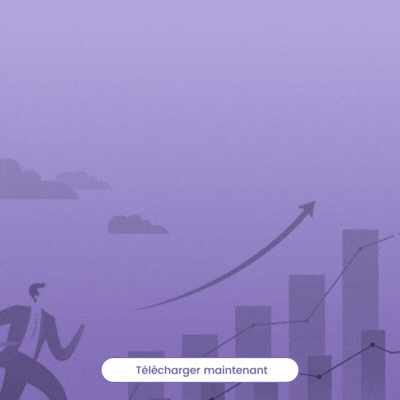Formellement, la loi du 24 juillet 1966 n’existe plus depuis la recodification du Code de commerce réalisée en 2000, mais elle subsiste substantiellement pour beaucoup de ses aspects car la codification s’est opérée à droit constant. Issue d’une longue réflexion commencée dès l’entre-deux-guerres et poursuivie presque continûment par diverses commissions successives, la réforme de la loi du 24 juillet 1867 avait été adoptée en juin 1966 mais publiée seulement le 24 juillet pour fêter les 99 ans qui séparaient les deux par un garde des Sceaux grand universitaire, Jean Foyer. La loi nouvelle avait intégré l’essentiel de la jurisprudence antérieure, mais aussi de la réglementation, en particulier celle issue des décrets-lois des années trente édictés à la suite de la crise économique de 1929 et de scandales politico-financiers (Stavinsky, Hanau, Oustric) précédés par celui de Panama à la fin du XIXe siècle. Elle avait également adopté par avance la future première directive en droit des sociétés de 1968, dont le texte était connu depuis 1964 (contrôle administratif ou judiciaire de la création de la société, limitation des nullités, pouvoir légal des dirigeants...). La loi de 1966 avait eu son heure de gloire lorsque la loi du 4 janvier 1978 avait réformé la partie du Code civil consacrée aux sociétés, dont le principal rédacteur, le regretté Pierre Bézard, en s’en inspirant, avait dit tout ce que cette dernière lui devait.
Depuis lors, elle a très souvent été ravaudée. Les textes successifs ont été très nombreux, au point d’être difficiles à recenser, ce qui a fait écrire à Bruno Oppetit en 1977 qu’il s’agissait d’une « entreprise de production industrielle de règles de droit qu’alimente en permanence la matière des sociétés commerciales depuis 1966 et qui ravirait un club de nomophiles ». L’inconvénient majeur de ces retouches et ajustements successifs est de n’avoir eu aucune préoccupation d’ensemble, même si quelques grandes réformes ont eu une cohérence interne (par exemple, la création des instruments financiers, la réforme des valeurs mobilières composées et des augmentations de capital, la réglementation des sociétés cotées et récemment le régime des restructurations intra-européennes), outre de nombreux textes extérieurs (par exemple l’ordonnance de 2023 sur les sociétés de professions libérales réglementées). Le droit des sociétés est devenu un manteau d’Arlequin.
Plus encore, ses finalités ont explosé. À l’origine, la loi était restée dans l’esprit du droit antérieur, qui consistait à mettre la société au service d’intérêts privés, celui des associés, ce qu’exprimaient à l’époque deux textes fondamentaux du Code civil, l’article 1832, qui lui attribuait un but lucratif au bénéfice des associés, et l’article 1833, qui imposait sa constitution dans l’intérêt commun des associés. Aussi, quand bien même dans l’esprit de l’arrêt Motte de 1946 et du système de la prokura emprunté au droit allemand par la première directive en droit des sociétés les dirigeants avaient reçu un pouvoir légal, ils devaient exercer celui-ci dans l’intérêt exclusif des associés.
Depuis lors, tout a évolué. Même s’il est difficile de dégager des lignes de force, on peut noter qu’un certain nombre de textes ont eu pour vocation de mettre la société au service d’une entité économique, l’entreprise, comme l’avait prôné une doctrine née à Rennes dans les années soixante, dont l’un des représentants les plus connus est le Professeur Jean Paillusseau, dont l’intitulé de la thèse reste dans toutes les mémoires : « La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise ». Ainsi, par exemple, pour les PME, furent autorisées les sociétés unipersonnelles, les EURL et EARL en 1985, puis les SASU en 1999, qui ont donné un statut à l’entreprise individuelle et une protection à l’entrepreneur ; mais c’est évidemment la création de la SAS en 1994 et surtout sa libéralisation en 1999 qui furent le point d’orgue de ce premier mouvement. C’est aussi la grande entreprise qui a été l’objet d’une attention, d’un côté par les textes successifs qui ont ouvert la porte de la société aux salariés, non plus seulement par l’intermédiaire des institutions représentatives du personnel relevant du droit du travail mais par leur entrée au conseil d’administration et au capital des grandes entreprises, même si on est loin de la cogestion à l’allemande pourtant envisagée par certains promoteurs de la loi de 1966 qui avaient introduit la formule du directoire et du conseil de surveillance lors de la discussion parlementaire (amendement Capitant-Le Douarec). Dans une tout autre perspective, il faut citer l’ordonnance de 2009, qui a créé la catégorie des instruments financiers, ou celle de 2020, qui a consacré un chapitre spécifique aux sociétés cotées, réformes qui doivent beaucoup à des travaux universitaires, mais également la diversification des valeurs mobilières, leur dématérialisation en 1982 et leur possible émission et transmission par un dispositif d’enregistrement électronique partagé (dans les sociétés non cotées).

Jusque-là, la société était restée au service d’intérêts privés, qu’il s’agisse des associés ou de l’entreprise, mais la nouveauté de ces dernières années est sa mise au service de l’intérêt général. On est passé d’un droit d’intérêt privé à un droit d’intérêt public, d’un droit classique à un droit que l’on peut qualifier de post-moderne. Le point d’application essentiel en est le mouvement de la RSE, qui a conduit à l’obligation pour les grandes sociétés de publier une déclaration de performance extra-financière en 2014 et maintenant un rapport de durabilité. Il faut également signaler la loi vigilance de 2017, qui impose la prise en compte par l’entreprise et sa chaîne de valeur des droits humains, des libertés fondamentales et de l’environnement. Le symbole de ce mouvement est la loi PACTE de 2019, qui a modifié l’article de 1833 du Code civil pour lui ajouter un alinéa 2 qui précise que la société doit être gérée dans son intérêt social « en prenant en considération les critères sociaux et environnementaux ».
Au résultat, l’entreprise devient l’auxiliaire de l’État pour la réalisation et la protection de l’intérêt général, ce qui aggrave définitivement le sentiment d’incohérence et de désordre du droit actuel des sociétés. Alors, peut-on rêver d’une réforme globale du droit des sociétés, d’une réforme d’ensemble, réfléchie et rationnelle, qui lui rendrait clarté et cohérence ? Il faudrait au minimum en dégager les finalités et les hiérarchiser, et tenir compte de critères de taille mieux pensés et harmonisés. Le projet n’est pas utopique et a été pris à bras-le-corps par l’Institut de la recherche en droit des affaires de Paris (IRDA) présidé par le Professeur France Drummond, qui, en concertation avec le Ministère de la Justice et la CCI d’Ile-de-France, a lancé un projet de réflexion pour la réforme du droit des sociétés dénommé « Reponds » (REflexions POur un Nouveau Droit des Sociétés), dont la direction scientifique a été confiée au Professeur Caroline Coupet. Un colloque de lancement a eu lieu sous sa direction le 16 janvier dernier, dont la remarquable organisation intellectuelle augure bien de l’avenir. n