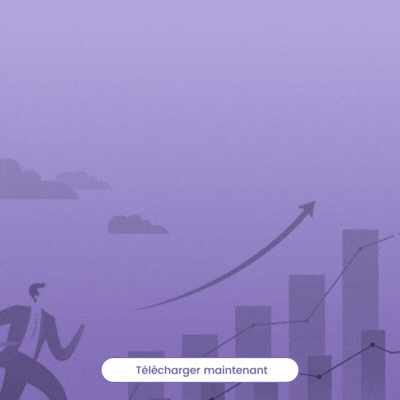Vous venez d’être nommée présidente du Comité du label ISR, en remplacement de Nicole Notat. Épargnants et professionnels vous connaissent peu. Qui êtes-vous, Michèle Pappalardo ?
Une ancienne fonctionnaire qui a quitté la haute fonction publique après plus de quarante ans de bons et loyaux services pour retrouver sa liberté de parole et de pensée. Retrouver est un terme un peu impropre, puisque comme j’ai toujours été fonctionnaire, je ne l’ai jamais eue complètement. Ce statut est synonyme d’obligation de réserve, de mise en œuvre des politiques publiques. Donc, on vend la politique que l’on mène. Là, je me mets volontairement dans une situation à la fois d’observatrice – ce n’est pas ma nature – et d’actrice. Et donc de pouvoir plus librement exprimer mes choix, mes doutes, mes souhaits sur les sujets sur lesquels je pense qu’il y a du travail à faire. Pendant ces quarante ans, j’ai passé un certain temps sur les sujets d’environnement, d’écologie… Autre caractéristique : j’ai une casquette de magistrat à la Cour des comptes, dont j’étais la rapporteure générale en 2019 et 2020. Ce qui est synonyme de préoccupation d’efficacité des politiques publiques et d’approche coût/résultat.
Vous avez été deux fois directrice de cabinet de ministre dans vos thématiques de prédilection. La première fois, c’était avec Michel Barnier, ministre de l’Environnement de 1993 à 1995. La seconde, c’était en 2017-2018 avec Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologie et solidaire. Les mots ont un sens et dans ce secteur, il en existe beaucoup. Quels sont ceux qui vous attirent le plus ?
Le développement durable. Je me souviens très bien avoir travaillé sur le sujet, déjà, avec Michel Barnier. On était tout au début, parce que le développement durable, c’est 1992, Rio… Le développement durable, c’est l’équilibre, la cohérence des actions. On ne peut pas faire que de la protection de l’environnement. Il faut faire de la protection de l’environnement en tenant compte des conséquences sociales des politiques menées, mais aussi de leurs coûts ou de leurs impacts économiques. Inversement, il faut se préoccuper des conséquences de l’économie sur l’environnement.
Avez-vous le sentiment que le monde tourne en rond ?
Non ! Et c’est vraiment un sujet mondial. Nous allons dans le mur, c’est clair. En même temps, je comprends pourquoi ; je vois bien où sont les obstacles, tout comme les contraintes pour faire changer les choses. En revanche, cela ne me décourage pas d’agir ni d’expliquer. Je pense que pour expliquer aux gens des choses extrêmement compliquées, il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et quand on y ajoute la notion de finances, ça devient encore plus complexe.
Nous sommes dans des problématiques écosystémiques, avec des sujets où tout est imbriqué. Il ne faut pas essayer de simplifier, parce que c’est la réalité qui est complexe. Il faut faire de la pédagogie sans simplifier. Pour moi, c’est un premier sujet très important. Ensuite, il faut chercher et proposer des solutions. En raison de mon expérience professionnelle, je sais que ça « passe » rarement du premier coup. Mais avec le temps, on finit par y arriver.
Pourquoi va-t-on dans le mur ?
Le modèle de production et de consommation de nos sociétés n’est pas supportable. Ce n’est pas un problème pour la planète, mais pour l’humanité. Notre modèle n’est plus tenable, d’autant que l’humanité continue à croître et qu’il n’y a aucune raison objective pour que tous les hommes n’aient pas envie de jouir du même modèle de consommation. Or, ce n’est pas possible, sauf à créer des perturbations majeures, comme celles que nous avons sur le climat aujourd’hui, qui est une résultante directe de ce mode de consommation et de production. À la limite, malheureusement, on pourrait imaginer que cela s’autorégule tout seul avec les conséquences catastrophiques du changement climatique. Mon objectif, dans toute ma carrière, a été d’anticiper pour éviter les crises. En fait, on va en arriver à utiliser les solutions qu’on propose depuis des années, mais sous contrainte et pas en anticipant.
Si on parvient à règler le problème environnemental, ne va-t-on pas devoir affronter, dans la foulée, un problème social ?
Ce n’est pas la bonne question. Puisqu’on n’a pas résolu le problème environnemental, on a et on va avoir d’énormes problèmes sociaux et sociétaux. C’est dans l’autre sens que se pose la question. Les conséquences du changement climatique vont d’abord atteindre les gens qui n’ont pas beaucoup de moyens. Il n'y a qu’à regarder ce qui passe aujourd’hui en Afrique ou en Asie. Des populations qui n’ont pas émis de CO2 se retrouvent sans eau, sans pâturages ou obligées de changer de localisation, comme dans les îles. Demain, ça nous touchera nous aussi et les moins riches sont ceux qui auront le plus de mal à résister. La bulle de chaleur, ce n'est pas au Canada mais chez nous qu'elle sera. Et puis, on aura chaque année un certain nombre d'inondations et d'incendies incontrôlables.
Selon la fameuse règle journalistique du « mort-kilomètre », signifiant qu’un lecteur sera plus intéressé par dix morts à dix kilomètres de chez lui que par dix mille morts à dix mille kilomètres, les choses peuvent changer…
C’est épuisant. On passe notre temps à annoncer ce qui va se passer et à expliquer ce qu’il faut faire pour l’éviter et on n’arrive pas à être entendu à temps. Tant qu’il n’y a pas un phénomène extérieur visible, on ne comprend pas vraiment le sujet. Quitte à échanger nos anecdotes professionnelles, permettez-moi de me souvenir de 2003. J’étais alors à l’Ademe et comme tous les cinq ans dans notre pays, il y avait un débat sur l’énergie. Nous voulions entrer dans le débat pour parler efficacité énergétique, énergies renouvelables… et il n’y avait pas moyen de prendre la parole. La place s’affrontait sur le charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire… Puis, à l’été 2003, il y a eu la canicule. Nous n’avons pas pu alors participer à tous les sujets et à tous les colloques où on nous a demandé d’intervenir. La canicule avait soudain fait prendre conscience que notre discours sur le changement climatique était digne d’intérêt…
Nos sociétés seraient-elles incapables de faire de la prévention, d'anticiper ?
C’est à craindre. Quand vous anticipez, vous déséquilibrez un équilibre à un moment donné. Il y a ceux qui y perdent : ils disent « pourquoi est-ce que je dois accepter de perdre maintenant uniquement parce que vous me dites qu’il va se passer quelque chose ? Moi, je n’en suis pas sûr. Et puis d’ici là, on trouvera bien des solutions… » On a beaucoup de mal à se projeter sur les générations futures. Dans notre société, les décisions ne sont généralement prises que sous la contrainte.
Votre regard sur ces sujets est-il scientifique ou financier ?
Ni l’un ni l’autre. Je ne suis ni une financière ni une scientifique, mais j’essaye de comprendre les uns et les autres. Parlons du rapport Meadows et du Club de Rome : c’était au début des années 70 et tout ce qui se passe aujourd’hui était écrit. Et pas par des excités, mais par des scientifiques. Je lisais les arguments. J’y ai cru avec, de temps en temps, des interrogations : « Pourquoi est-ce que tu y crois alors qu’il y a plein de gens qui n’ont pas l’air plus idiot que toi et qui n’y croient pas ? » Moi, j’ai été convaincue par la démonstration, par les annonces qu’on a systématiquement vérifiées. Tout ce qui était écrit, on l’a vu se dérouler. On savait déjà des tas de choses au moment de Rio, en 1992. Rio, c’est un moment majeur. Jusque-là, des trois « parties » du développement durable – le social, l’économique et l’environnemental – il y en avait une qui ne parlait pas. C'est l’environnement. Et là, il a commencé à s’exprimer. Quand je regarde avec le recul, depuis Rio, j’ai vraiment le sentiment qu’on a perdu trente ans.
Quels sont le rôle et la responsabilité de la finance ?
Ils ne sont ni moins ni plus grands que ceux des autres acteurs économiques, qui sont tous interdépendants. Les financiers n’y ont pas plus cru que les autres, pour une grande partie d’entre eux. Globalement, leur objectif est de faire des bénéfices pour eux et pour les gens qui placent leur argent chez eux. Mais ça commence à bouger. Les entreprises commencent aussi à s’interroger sur leur impact. Dans mon esprit, la finance arrive dans un second temps, car ce n’est pas elle qui produit. S’il n’y a pas d’entreprises qui proposent des solutions, il n’y a rien de bien à financer.
Cela dit, c’est une excellente chose que la finance se mobilise, même si ça passe aujourd’hui par plein de greenwashing. Mais c’est inévitable, on passe toujours par cette étape en matière d’environnement : ça commence toujours par plein de discours de bonne volonté. Certains sont crédibles, d’autres pas. D’où la nécessité de normes, de labels… Pendant des années, j’ai passé mon temps à dire : « On fait des choses avec les entreprises, on fait des choses avec les particuliers, mais tant que les financiers ne suivront pas, on n’avancera pas. » La finance s’y met, c’est bien, mais elle ne peut pas tout résoudre. Les entreprises doivent aussi évoluer dans le sens de plus de RSE, plus de lutte contre le changement climatique…
Vous disiez que depuis Rio, on a perdu trente ans…
Précisons : des choses ont été faites. On a quand même réussi à développer des énergies renouvelables, à commencer à lutter contre le gaspillage, etc. Mais nous ne sommes pas là où nous devrions être. Autre sujet : les acteurs publics ou économiques qui interviennent aujourd’hui sur ces sujets les reprennent là où on était il y a trente ans. Ils nous disent : « On veut réduire nos émissions, mais il ne faut pas que ça aille trop vite parce que sinon ça va tout bouleverser. » Or ça, ce n’est plus possible. Il y a 30 ans, on avait le temps. Aujourd’hui, on n’a plus le temps : il faut se dépêcher et agir vite et fort.
Justement, parlons du label ISR. Il est établi sur la règle du best in class, c’est-à-dire du relatif. À l’heure de l’urgence évoquée, ne faut-il pas plaider pour l’exclusion, c’est-à-dire l’approche de l’absolu ?
Je pense qu’il faut emprunter toutes ces voies. Mais soyons clairs : le relatif, comme vous dites, a surtout pour vocation de pouvoir soutenir tous les secteurs et de faire avancer toute l’économie. Ce n’est pas en se concentrant uniquement sur les bons qu’on fera réellement changer le modèle. De ça, je suis assez convaincue. Établissons aussi une distinction entre les banques, qui financent des projets, et les fonds, qui financent des entreprises. Or, une entreprise peut avoir de bons projets ou activités et des mauvais ; ça rend plus difficile les progrès des fonds.
Prenons le cas des entreprises du secteur de l’énergie. Disons qu’aujourd’hui, pour être financées par la finance verte, elles doivent se débarrasser de leurs activités dans les énergies fossiles non conventionnelles. À première vue, c’est plein de bon sens. Mais la finance verte, même si elle pèse de plus en plus, n’est pas la seule source de financement. D’autres financeurs « non verts » iront donc financer les énergies non conventionnelles et, au global, rien n’aura changé pour le climat. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui, dans la réalité.
Certes, je comprends le choix de faire des exclusions. Mais je crois aussi qu’on peut avoir une démarche plus globale, avec laquelle je suis peut-être intellectuellement plus en adéquation. Le sujet, c’est un changement de modèle. Tout le monde doit bouger. C’est peut-être moins facile à vendre, mais probablement plus efficace aussi. En pratique, je pense qu’il faut offrir toutes les options aux investisseurs et aux épargnants.
Que pensez-vous du label ISR français ?
Les Français ont été pionniers sur le principe même d'un label sur l’ISR. Il ne faut pas l’oublier et nous devons conserver cet esprit pionnier sur ces sujets. Or, la connaissance et la pratique ont globalement avancé et progressé sur toutes les places. Il nous faut avancer, faute de quoi nous finirons à la traîne. Il faut être plus exigeant, plus clair…
Pensez-vous que les choses soient claires pour un épargnant qui achète un produit ISR ou un conseiller qui en vend un ?
Non, mais c’est compréhensible, parce que nous n’en sommes qu’au début. J’ai rencontré ce type de situation sur tous nos sujets environnementaux. Au début, c’est la foire d’empoigne : il y a les ultras, les « surtout on ne fait rien »… d’autant que dans un premier temps, les concepts et définitions ne sont pas clairs du tout. Il faut alors préciser ce qu’on veut : c’est un travail entre spécialistes.
L’étape d’après, c’est celle de la compréhension par le grand public, après une phase parfois longue de pédagogie. On a vécu la même chose sur le climat. Au début, personne n’y comprenait rien et on mélangeait toutes les notions. Alors pensez, la finance durable ! À la complexité du changement climatique et de nos autres sujets environnementaux s’ajoute la complexité de la finance.
Aujourd’hui, un épargnant lambda ne comprend probablement pas bien ce qui lui est proposé. Et certainement parce que l’on n’a pas défini suffisamment ce dont on parle et ce que l’on veut faire. Chacun vient avec sa définition, ce qui génère encore un peu plus de complexité. Il y a ceux qui font des choses très, très bien, ceux qui font volontairement n’importe quoi, et enfin ceux qui font n’importe quoi sans le vouloir, juste parce qu’ils ne savent pas vraiment ce qu’ils doivent faire. Il faut clarifier les notions et les outils. Pour certains, un fonds labellisé, c’est forcément un fonds qui lutte contre le changement climatique, qui doit être en phase avec la COP21 et l’objectif 1,5 °C. Mais ce n’est pas ce qui est écrit dans le référentiel du label !
Le label ISR est aujourd’hui positionné sur des best practices. Il ne faut pas le vendre pour autre chose que ce qu’il est : c’est déjà beaucoup, mais ce n’est que le début. on peut faire une comparaison avec ce que l’on a fait dans d’autres domaines, par exemple pour l’électroménager. Aujourd’hui, quand on achète un réfrigérateur, on ne trouve plus que des appareils avec des étiquettes A, A+, A++, A+++… Mais il n’y a pas si longtemps, il y avait des réfrigérateurs classés E ou F. Comment les a-t-on sortis du marché ? En commençant par mettre des étiquettes volontairement, puis en les rendant obligatoires et en interdisant progressivement les classements les plus mauvais. Mais les normes n’ont fait que suivre l’évolution du marché, parce que les clients ne voulaient pas acheter des appareils avec de mauvaises notations. C’est comme ça que l’on avance et ça peut aller vite. Il faut qu’il se passe la même chose avec les fonds.
Le « 6, 8 et 9 » de l’Union européenne dans le règlement SFDR n’est-il pas plus discriminant et compréhensible que le label français ?
Si vous voulez dire que les définitions des articles 6, 8 ou 9 sont plus simples que le référentiel du label ISR, qui ne se lit pas facilement, ma réponse est oui. Pour le reste, pardon, mais pour l’heure, il n’y a pas photo. Dans cette approche européenne, vous êtes dans le déclaratif, vous vous auto-évaluez. Et sans attendre, on voit déjà des petits malins qui affichent leur « auto-classement » dans l’article 9 en le valorisant visuellement comme si c’était un label. Pour le moment, ce n’est pas clair du tout, mais ça le deviendra probablement au fur et à mesure de la publication des règlements. Mais là, on pourra aussi dire adieu à la simplicité… La démarche européenne, c’est de fixer un cadre puis d’édicter des réglementations. Dans la période située entre le cadre et la réglementation, qui doit être la plus courte possible, on voit comment les acteurs s’approprient le cadre. Mais on a besoin très vite de précisions et de référentiels qui sont en général détaillés et complexes.
Le label ISR fonctionne aujourd’hui sur la validation d’un proccess. Ne peut-on pas faire autrement ?
Au début, il faut commencer par le process, parce que c’est la base de ce que l’on pourra faire ensuite : engagement, transparence, contrôle, ce sont les grandes forces du label. La question, c’est l’étape d’après. Pour l’heure, on ne prévoit pas de mesure d’impact, car ce n’est pas l’objet du référentiel actuel du label ISR. Et la mesure d’impact est un exercice compliqué. Mais des réflexions sont en cours dans ce domaine. Dans mon esprit, à un moment, il faudra voir comment on intègre ce thème de l’impact dans le référentiel du label.
Concernant les référentiels, comment tenez-vous compte des évolutions sur l’offre de la place ?
Parallèlement à nos réflexions sur l’évolution du référentiel, il nous faut être très exigeants sur la manière dont le référentiel actuel est appliqué. Et ce n’est pas simple, car à chaque fois que de nouveaux fonds sont créés, cela pose de nouvelles questions. C’est pourquoi nous avons publié à la fin du mois de novembre le premier fascicule du « guide de la maintenance du référentiel », qui donne, sur plusieurs points, certes techniques, l’interprétation qu’il faut faire du référentiel ; ce travail sera complété régulièrement. Le référentiel initial n’a pas tout prévu et n’est pas toujours très clair. Il faut donc que tout le monde l’interprète de la même manière. Mais c’est bien un guide d’interprétation, il ne modifie donc pas le référentiel, même si son rôle est important.
Quand il y a un choix à faire dans l’interprétation d’un point du référentiel, vous pouvez retenir différentes solutions, de la plus facile à mettre en œuvre à la plus exigeante. Les trois certificateurs n’ont pas toujours fait les mêmes choix d’interprétation. Nous nous livrons donc à un travail d’homogénéisation, ce qui est synonyme d’arbitrage plus que de consensus, quand on recherche une plus grande exigence. Du coup, certains fonds vont devoir évoluer ou sortir du label. En effet, pour le client, son fonds doit être en ligne avec le label à tout moment. Mais ce n’est qu’une première phase de notre travail, celle qui porte sur le référentiel actuel. En parallèle, nous réfléchissons à faire évoluer le référentiel lui-même.
Dans le monde du solidaire, le fonds Insertion emplois est un véritable succès, car il dit ce qu’il fait. Croyez-vous qu’un épargnant ait envie de faire de l’ISR globalement ? Ou, qu'il est parvenu à comprendre ce que tous ces acronymes, ESG ou RSE, veulent dire ?
Comme vous le laissez entendre, je trouve que ces sigles, pour des « gens normaux », n’ont strictement aucun sens. En particulier l'investissement socialement responsable… Qu’est-ce qu’un non-spécialiste comprend ? Il entend social, mais rien sur l’environnement. Je ne sais pas s’il faut changer le nom du label mais, en tout cas, si on le garde, il faut vraiment faire beaucoup de communication et de pédagogie pour expliquer ce dont il s’agit et ce que l’on veut obtenir. J’ai connu le même phénomène avec le « développement durable » à la fin du siècle dernier : tout le monde nous disait que le terme était invendable, que personne ne comprendrait jamais de quoi il s’agissait. On a tenu bon et maintenant, les gens savent à peu près ce dont il s’agit, même s’il y en a encore qui ne voient que la dimension environnementale. Avec le terme ISR, c’est assez semblable.
Soit mais, sur le fond, les épargnants ne préfèrent-ils pas un sujet précis plutôt qu’une approche globale ?
C'est surtout le travail des fonds d’aller sur les sujets thématiques et de répondre ainsi aux attentes des épargnants et des investisseurs. Pour autant, une réflexion doit être ouverte sur ce que j’appellerais un « bouquet de labels ». Il faut expliquer aux épargnants qu’ils ont la possibilité de choisir un label. Notre rôle, c’est d’assurer, à travers les labels, la qualité des différents types de fonds dans lesquels les épargnants peuvent avoir envie de mettre leur argent.
Personnellement, je vois le label ISR comme une espèce de socle, ce que vous comprendrez bien, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l’heure sur la nécessité de faire avancer globalement toutes les entreprises vers un développement plus durable. Après, on peut avoir envie de mettre un accent particulier sur le climat, la biodiversité, le social, les droits de l’homme… Ce sont des sujets très différents sur lesquels certains épargnants peuvent avoir envie de s’engager au-delà d’une démarche transversale de RSE.
Je vais plus loin : on devrait même avoir différents niveaux d’exigence de cette démarche de RSE. L’intérêt d’avoir une gradation sur l’exigence, c’est que personne n’aime avoir une seule étoile : on préfère en avoir deux ou trois. Donc ça encourage tout le monde à progresser, ce qui me ramène à l’histoire de mes réfrigérateurs.
Je crois en cette démarche-là, à condition que ce ne soit pas du toc, à condition qu’il y ait une vraie exigence et des vrais contrôles… L’objectif est de mettre l’ensemble du système sous pression. Parce que mon rêve, c’est que finalement tous les fonds soient labellisés ISR, et si possible aux plus hauts niveaux d’exigence.
Le monde peut-il être entièrement ISR ?
C’est la logique de la démarche, même si c’est probablement irréaliste. Mais l’objectif, c’est bien de changer globalement le modèle !
On a beaucoup parlé du E, aussi du S, mais pas du G. Juste une question sur le sujet. Je vous ai lu, vous félicitant de l’ouverture du Comité du label à l’ensemble des parties prenantes. Or, je constate l’absence des ONG…
Je ne suis pas sûre qu’il faille les mettre dans ce genre d’organisme. Les ONG doivent garder leur rôle critique et si on les intègre dans les organismes de proposition-décision-action, on les met souvent en porte à faux. Il faut leur laisser leur liberté totale d’action et d’intervention, il faut qu’on les écoute, qu’on discute avec elles, et c’est précisément ce que l'on fait, par exemple dans les sous-comités qui alimentent les réflexions du Comité du label. La nouveauté, c’est que les membres autour de la table du Comité, s’ils sont convaincus par le sujet, apportent chacun clairement des points de vue différents du fait de leur positionnement dans le monde de la finance. Par ailleurs, je vous rappelle que le Comité du label ne décide pas. Il fait des propositions et le ministre décide.
Vous avez mentionné tout à l’heure votre ambition de permettre à la France de rester pionnier. Avec quel objectif ? L’ensemble des agences de notation extra-financière sont déjà passées sous pavillon américain.
Il faut savoir reconnaître les choses qu’on fait et qu’on fait bien… et celles pour lesquelles on est moins bons. Nous étions déjà pionniers, par exemple, avec la loi sur les Nouvelles régulations économiques en 2001. Nous l’avons été avec le label ISR en 2016. Nous, les Français, sommes souvent bons pour élaborer les concepts, moins pour leur mise en œuvre. Mon objectif, c’est de faire en sorte que le concept ait une réalité opérationnelle, de faire avancer tout le monde derrière et, si possible, de retrouver un temps d’avance dans ce domaine.
Plus vite, plus clair, plus exigeant, plus efficace, tels sont préconisations pour le label ISR. Vous êtes une femme engagée et m’avez indiqué, pour commencer, votre plaisir d'avoir votre liberté de parole. Je vous laisse donc conclure notre échange sur le sujet de votre choix…
Je ne sais pas encore très bien quel lien il faut faire avec la finance, mais je vous remercie de me donner l’occasion de dire un mot sur un sujet qui me préoccupe vraiment aujourd’hui, je veux parler de l’adaptation aux conséquences du changement climatique, autrement dit les catastrophes qui vont se multiplier et s’intensifier, comme le précise clairement le dernier rapport du GIEC.
Cela devrait nous conduire à réfléchir très différemment à nos stratégies, nos investissements, nos actions… Je pense, par exemple, qu’on devrait tous réfléchir à être plus résilients, individuellement et collectivement. Cela signifie que chaque territoire doit se préoccuper de savoir comment il peut fonctionner en autonomie, certes dans un mode dégradé, pendant un certain temps. En effet, que se passe-t-il en cas de catastrophe climatique (chaleur, inondation, cyclone, incendie…) ? Il y a des ruptures de réseaux, notamment électriques.
Tout le monde a en tête la vallée de la Roya, mais dans une vallée comme celle-ci, un problème d’inondation paraît presque évident. Tel n’était pas le cas lors des inondations cette année en Allemagne, où l'on attend pas du tout ce type de catastrophe. Même surprise au Canada, avec ses températures à 50 degrés. Comment va-t-on s’adapter pour limiter autant que possible les conséquences de ces phénomènes ? Mieux vaut ne pas attendre la catastrophe avant d’y avoir réfléchi et d’avoir pris les mesures. Le temps presse et, pour le moment, je ne vois pas de mobilisation sur ce sujet.
Propos recueillis par Jean-François Filliatre.