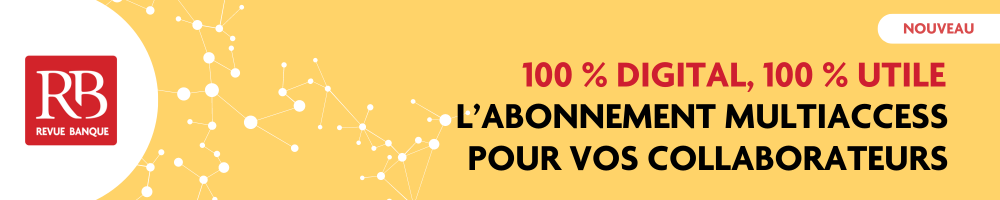
Obligations légales
La réglementation renforce la responsabilité des acteurs financiers en matière de cybersécurité
Créé le
20.12.2017-
Mis à jour le
15.01.2018Face à l’évolution des cybermenaces, anticiper et organiser la cybersécurité est une nécessité. C’est également une obligation qui s’intensifie : la réglementation française et européenne contraint à amplifier la sécurité du numérique. Toutes les organisations sont concernées et plus particulièrement le secteur financier.
La sécurité du numérique est un enjeu majeur. Il s’agit de protéger les données, les clients et la continuité d’activité. Or la volonté de l’Union européenne (UE) est de promouvoir l’industrie du numérique et de défendre un modèle démocratique assurant la protection des droits fondamentaux.
Cette évolution de la régulation bouscule les pratiques des entreprises. Se conformer aux nouvelles règles signifie s’approprier la connaissance, gérer ce risque ...


![[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation [Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/MEBW/gettyimages-968963256-frais-bancaires_221-3514277_20240417171729.jpg)




