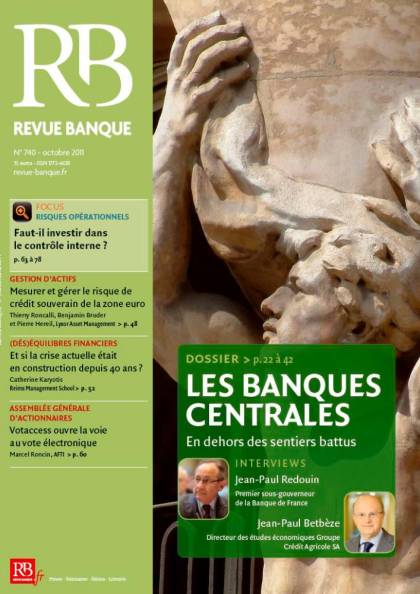> Lire aussi l'interview de Paul De Grauwe : « Sans injection de liquidité, le système imploserait »
Est-ce le rôle d’une banque centrale d’acheter de la dette souveraine des pays qu’elle couvre ?
Il n’y a pas de réponse simple à cette question. Que les banques centrales soient nettement séparées des instances budgétaires est absolument nécessaire, afin d’éviter qu’elles ne créent de la monnaie pour de mauvaises raisons. Mais lorsque la dette publique est sur le point d’exploser, il est presque impossible pour la banque centrale du pays de fermer les yeux. C’est ainsi que la Fed a racheté des quantités massives de bons du Trésor depuis trois ans. La bonne réponse, pour une banque centrale, est donc : « Je ne le ferai jamais, sauf si… ». On est en train de vivre cette exception à la règle.
Ce rôle de prêteur en dernier ressort pour les États est-il encore plus nécessaire dans le cas européen, avec 17 politiques budgétaires et une seule monnaie ?
Non, au contraire. En décidant d’acheter de la dette grecque en mai 2010, la BCE et les gouvernements ont, à mon sens, violé l’article 125 du Traité de Maastricht qui interdit à tout pays membre ou à la banque centrale d’aider un autre membre en difficulté avec son budget. Cette décision a marqué le début de tous les problèmes qui ont suivi. La zone euro a été conçue de telle sorte qu’il n’y ait pas d’exception à la règle, et c’était selon moi une bonne chose. En effet, dans notre cas, le risque d’aléa moral est amplifié : non seulement les gouvernements peuvent être tentés de faire financer leur déficit par la banque centrale, mais ils peuvent aussi avoir tendance à vouloir faire payer les autres membres. Le Traité de Maastricht apportait une réponse claire et précise, celle de l’inflexibilité. En intervenant, la BCE a commis une grave erreur stratégique et elle a semé le doute. Les marchés auraient pu gérer un défaut grec car ils auraient été fixés sur la valeur des titres qu’ils détenaient : les pertes subies sont toujours moins angoissantes que celles à venir. La BCE n’a désormais plus qu’à boire le calice jusqu’à la lie.
La BCE précise pourtant qu’elle passera le relais au Fonds européen de stabilité financière (FESF) dès que possible…
Cela amplifie ces angoisses : si l’on additionne la dette des pays traités par le FESF et celle de l’Italie et de l’Espagne, on atteint 35 % du PIB européen, 50 % si on ajoute la France. Face à des telles sommes, seule la BCE peut intervenir. La crise peut prendre fin de deux manières : la BCE assume son nouveau rôle et garantit les dettes publiques pour arrêter immédiatement la crise ; ou bien elle continue de tergiverser en intervenant par petites touches et à contrecœur, ce qui sera bien plus difficile et coûteux.
À quel mécanisme de garantie faites-vous référence ?
Cela consisterait pour la banque centrale à se dire prête à racheter autant de dette souveraine qu’il le faut pour stopper la spéculation. Dans un premier temps, elle pourrait garantir les dettes existantes à hauteur de 50 % de leur valeur, par exemple. Cela fournirait au marché un prix plancher et donc un montant maximal de pertes. On pourra alors entrer dans un mécanisme de résolution de crise. Dans un second temps, la BCE pourrait garantir les dettes futures des pays européens pour rendre l’accès aux marchés à ceux qui l’ont perdu. En échange de cette garantie, les pays devraient appliquer des conditions extrêmement strictes sur l’orientation de leur politique budgétaire. En cas de violation de ces règles, la garantie de la BCE tomberait.
Cela ne risquerait-il pas de faire flamber l’inflation ?
Si la garantie était crédible, la BCE n’aurait même pas à racheter de dette. Si, au contraire, les marchés cherchaient à la « tester », elle devrait effectivement absorber des sommes importantes de dettes et voir son bilan s’accroître. Ce qui ne signifierait pas hausse de l’inflation : tout d’abord, notre croissance n’est pas suffisante pour en générer ; et surtout, l’inflation n’apparaît que si la monnaie de banque centrale est transformée en crédits à l’économie, ce que la BCE a les moyens d’éviter.
La BCE pourrait-elle laisser l’inflation s’accroître pour réduire le niveau d’endettement ?
L’inflation ne se décrète pas. Les tensions n’apparaissent qu’un ou deux ans après une reprise économique. Dans le cas de la zone euro, ce n’est pas pour demain. Ceci étant dit, il faut voir l’inflation comme une taxe, au même titre que peut l’être un défaut partiel. Mais elle est plus inéquitable socialement, car elle touche en particulier les personnes les moins favorisées qui ne savent pas se prémunir contre elle. Un défaut, au contraire, touche les investisseurs qui détiennent des titres, généralement plus aisés que la moyenne.
Par ailleurs, je doute de l’efficacité de la mesure : l’assiette est réduite, une partie de la dette étant indexée sur l’inflation, et un taux d’inflation à 5 % ne procurerait que de faibles revenus, seule une flambée à deux chiffres pouvant être efficace, mais à quel prix !
Que change la crise actuelle sur l’indépendance de la zone euro ?
L’indépendance formelle de la BCE est garantie par le Traité de Maastricht. Les banquiers centraux européens sont nommés pour de très longues périodes, non renouvelables et peuvent donc tenir tête aux gouvernements. En rachetant de la dette grecque en mai 2010, Jean-Claude Trichet a cédé à la pression des États. C’est une atteinte très grave à la crédibilité de la BCE, mais pas à son indépendance qui est formellement garantie. À son actif toutefois, il faut rappeler ses admonestations mensuelles pour une plus grande discipline budgétaire, car il savait que c’était le talon d’Achille de l’Union monétaire. Mais cette pression est maladroite, par exemple face à l’Italie : la BCE doit demander des règles budgétaires strictes, précises et pas des engagements à réaliser après les élections !
Quels risques pèsent sur le bilan de la BCE avec ce programme de rachat ?
La BCE a pris sur son bilan des sommes importantes de dettes toxiques. Des restructurations de dettes généreraient donc des pertes pour elle. Elle pourrait même se retrouver avec un capital négatif, ce qui l’inquiète beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi : le fait qu’elle puisse fabriquer de la monnaie rend son bilan essentiellement cosmétique. Il y a des banques centrales à travers le monde dont les capitaux propres sont
Achevé de rédiger le 19 septembre 2011