Comment parvenir à drainer l’épargne des Français vers le financement de l’économie ?
L’orientation de l’épargne en France dépend de deux facteurs :
- de la perception des épargnants, notamment en matière de risque. Ce facteur joue actuellement en faveur des placements qui leur semblent sûrs (l’épargne courte), les plus garantis possibles (l’immobilier) et, dans une certaine mesure encore, l’assurance vie ;
- de la fiscalité, qui a, en matière d’épargne, un rôle décisif puisqu’elle crée des différences considérables entre les produits. Elle joue actuellement massivement en faveur de l’épargne courte placée sur les livrets défiscalisés, mais aussi de l’assurance vie et de façon plus limitée des dispositifs spéciaux, comme le PEA pour les actions.
Le motif avancé pour aligner la taxation des revenus du capital sur ceux du travail n’est pas celui de l’efficacité économique, mais de la justice. Pourtant, il me paraît évident que la justice consiste d’abord à imposer le revenu réel de l’épargnant, qui est un revenu après
Au minimum, aucune raison ne justifie que des régimes fiscaux différents soient appliqués à des produits de durée et de risque comparable, par exemple entre l’assurance vie et la détention directe de portefeuilles d’actions ou d’obligations avec les mêmes engagements de durée.
Le gouvernement justifie les mesures concernant le livret A par la nécessité de financer le logement social notamment…
Cette position pourrait se comprendre s’il n’y avait pas d’autres moyens de financer le logement social. Ce n’est évidemment pas le cas et la logique comme la bonne gestion prudente est de financer ce qui est un investissement immobilier par des ressources longues, c'est-à-dire des emprunts obligataires et certainement pas par un livret à vue. D’autant que le livret A crée actuellement une autre distorsion qui n’est pas fiscale : il garantit un taux élevé pour un placement à court terme, supérieur à l’inflation, alors que les taux à court terme de la BCE sont aujourd’hui très en deçà. Cela veut dire que les ressources des livrets sont très coûteuses pour les organismes qui récupèrent ces fonds. Du fait de cette référence, les banques sont en outre obligées d’offrir des rémunérations pour leurs comptes à terme ou livrets trop élevées par rapport au marché, et contraire aux objectifs de la BCE, laquelle souhaiterait des taux plus bas. Cette surrémunération factice de l’épargne s’oppose donc frontalement à la transmission de la politique monétaire. Notre système est plus aberrant que jamais.
Les actions sont de leur côté et de très loin la forme d’épargne la plus désirable socialement, car elles financent la prise de risque et donc la construction de l’avenir, tout en permettant l’orientation de la politique des entreprises et leur contrôle. Il est notamment vital pour un pays de contrôler une part appréciable du capital de ses entreprises. Or, depuis longtemps, elles sont le parent pauvre du système français. Actuellement ce défaut est aggravé non seulement par les évolutions fiscales, mais aussi par les règles de Bâle III et surtout de Solvabilité 2, qui rendent très difficiles pour les banques, et dans une mesure élevée les assureurs, d’acheter des actions. La France est le seul grand pays développé qui n’a plus d’acheteurs naturels d’actions, par rapport à ses voisins qui ne présentent pas les mêmes distorsions et ont des fonds de pension ou des hedge funds qui investissent en actions. Il y a aujourd’hui un besoin collectif majeur de changer radicalement ce paysage, pour encourager massivement l’achat et la détention d’actions.
Quelles mesures préconisez-vous pour encourager l’investissement en actions ?
Le PEA reste la seule exception en la matière, mais il remplit une fonction limitée car son plafond d’investissement est bas. En outre, il ne joue que sur la rémunération de l’investissement. Des mesures beaucoup plus incitatives sont nécessaires si l’on veut que les Français reviennent sur les actions.
En particulier, il convient de développer l’investissement en actions des fonds destinés aux retraites. Le gouvernement Jospin, qui avait instauré le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), avait à cet égard vu juste. Sa disparition est une erreur grave.
Pensez-vous, comme certains, que l’investissement dans l’immobilier est également trop encouragé ?
L’immobilier est en soi un investissement collectivement utile, car il est évidemment bon que les personnes se logent et que l’on fabrique des logements. Le problème de ce placement est, d’un côté, une offre foncière insuffisante et, de l’autre, un régime fiscal très favorable, notamment dans le cas de la résidence principale. Il faudrait probablement réduire ces avantages et augmenter l’offre foncière.
Votre constat est assez pessimiste : l’épargne, pourtant abondante, des Français n’irrigue pas aujourd’hui correctement l’économie…
C’est d’autant plus grave que le dispositif réglementaire Bâle III, dans toutes ses formes, va entraîner pour les entreprises un recours plus grand aux marchés financiers. Nous avons donc un devoir collectif de faire en sorte de trouver sur les marchés financiers, non seulement une offre de produits, mais aussi une demande, c'est-à-dire de l’épargne prête à s’investir en actions et obligations. Il faut aussi être équipé pour cela : c'est-à-dire avoir une industrie financière des marchés. Or dans ce domaine, les mesures ou projets réglementaires en cours de discussion sont également défavorables aux banques d’investissement françaises, notamment en matière de structure des établissements. La séparation des activités peut présenter un risque élevé pour leur capacité à jouer leur rôle sur les marchés financiers.
Face à cette pénurie, comment les entreprises peuvent-elles se financer ?
Les grandes entreprises peuvent faire appel à l’épargne étrangère. Elles le font d’ailleurs depuis plusieurs années ; elles ont considérablement accru leurs emprunts obligataires hors de France, et en termes d’actions, elles sont visibles au niveau international. Mais il n’est pas bon qu’elles soient les seules entreprises mondiales avec une part si faible d’investisseurs de leur pays d’origine dans le capital. Cela les rend vulnérables.
Les entreprises moyennes et a fortiori plus petites n’ont pas ces possibilités. Elles auraient besoin d’un recours au marché domestique, en actions ou en obligations. Mais pour cela, il ne suffit pas d’avoir des structures comme le projet de Bourse de l’entreprise actuellement discuté, il faut avoir des ressources, c'est-à-dire parvenir à mobiliser l’épargne. Cette idée de Bourse est plutôt bonne, mais c’est comme une voiture sans essence. De même, il ne suffira pas de créer un PEA PME ; des incitations beaucoup plus fortes sont nécessaires.
De quelle nature ?
Ces incitations devraient avoir un poids psychologique fort, comparable à celui du dispositif Monory dans les années 1980.
Inversement, de nombreuses exemptions qui n’ont pas de sens devraient être supprimées, par exemple sur les produits d’épargne de court terme, qui ne constituent pas de l’épargne stable et utile.
Comment se faire entendre à Bercy ?
Le problème n’est pas à Bercy mais au niveau politique. On peut espérer que dans le cadre des réflexions sur la compétitivité menées par Louis Gallois, ou de la mission sur l’épargne longue confiée aux parlementaires Karine Berger et Dominique Lefebvre, ces raisonnements seront pris en considération. Un grand tournant doit être opéré, pour des raisons non pas idéologiques, mais strictement pragmatiques.
Dans cette perspective, l’autorité publique a son rôle à jouer, notamment en termes de garant des procédures. Le FRR en était un très bon exemple. Il a été instauré par le gouvernement, mais il mettait l’autorité de l’État derrière une objectivité procédurale : les Français savaient que leur argent était géré dans le cadre de procédures établies de façon partenariale entre les partenaires sociaux, des parlementaires et des représentants des ministères de tutelle. Sur une telle base, il est possible de permettre aux Français de confier une partie de leur retraite à des dispositifs de type capitalisation, en complément de la répartition. Il y aurait un intérêt fort à développer cette idée de capitalisation dans un tel cadre : compte tenu du contexte français, cela paraît beaucoup plus faisable sous une ombrelle publique comme Lionel Jospin avait commencé à le faire. Mais il faut aller beaucoup plus loin et rien n’empêche de revitaliser le FRR, qui existe toujours, même s’il est aujourd’hui géré en extinction. Cela me parait une priorité forte. Une autre modalité à étudier dans cette optique est le projet que propose Philippe Tibi, dans le corps de ce
Que pensez-vous de la BPI lancée par le gouvernement pour faciliter le financement des PME ?
La BPI, pour ce qui en a été rendu public, utilisera essentiellement des ressources existantes. Côté crédit, elle repose sur Oséo dont l’action est unanimement saluée et qu’il faut maintenir. D’ailleurs, il n’y a pas de problème de crédit solvable en France, comme en témoigne la médiation du crédit.
En revanche, notre économie manque de fonds propres. Dans ce domaine, comme mentionné précédemment, les banques et les assurances, dans l’état actuel des réglementations Bâle II et Solvabilité 2, sont très gênées pour intervenir. Mais, parallèlement, les expériences passées de gestion publique d’investissement en fonds propres ne sont guère concluantes. Le projet de BPI présente à cet égard un problème d’orientation objective de l’épargne, pour éviter qu’elle ne soit prise dans les influences politiques. Et en tout état de cause, son potentiel est relativement faible, bien inférieur à ce que pouvait afficher le capital risque dans ses meilleures années. Il faut l’admettre clairement, les capacités du marché sont de nos jours massivement supérieures à celles de l’État, aujourd’hui en outre très endetté.
Les Français n’ont-ils pas aussi un problème culturel avec les investissements sur les marchés financiers ?
L’histoire montre que les Français ont eu une Bourse extrêmement active, notamment jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ce n’était pas un peuple radicalement différent de celui d’aujourd’hui. Je ne crois donc pas à cette explication psychologique. Certes, la France souffre depuis des siècles d’un rôle totalement disproportionné donné à l’État, mais cela n’a pas empêché historiquement le marché des actions de se développer. Et comme le montre l’exemple du FRR, État et marchés peuvent coopérer ; un gouvernement socialiste peut même être bien placé pour organiser cette jonction. C’est là un motif d’espérance : il peut y avoir là une direction intéressante pour un tel gouvernement, mais qui ne peut s’enclencher que sur la base d’une analyse profondément renouvelée de la situation.



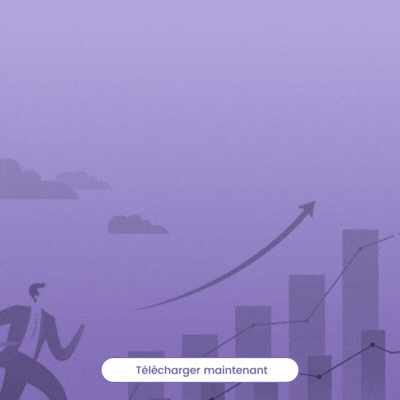
![[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation [Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/MEBW/gettyimages-968963256-frais-bancaires_221-3514277_20240417171729.jpg)




